Enter the void
DIRECTOR : Gaspar Noé
PRODUCTION : Wild Bunch - BUF - Fidélité
VFX SUPERVISORS : Pierre Buffin / Geoffrey Niquet
VFX PRODUCER : Nicolas Delval
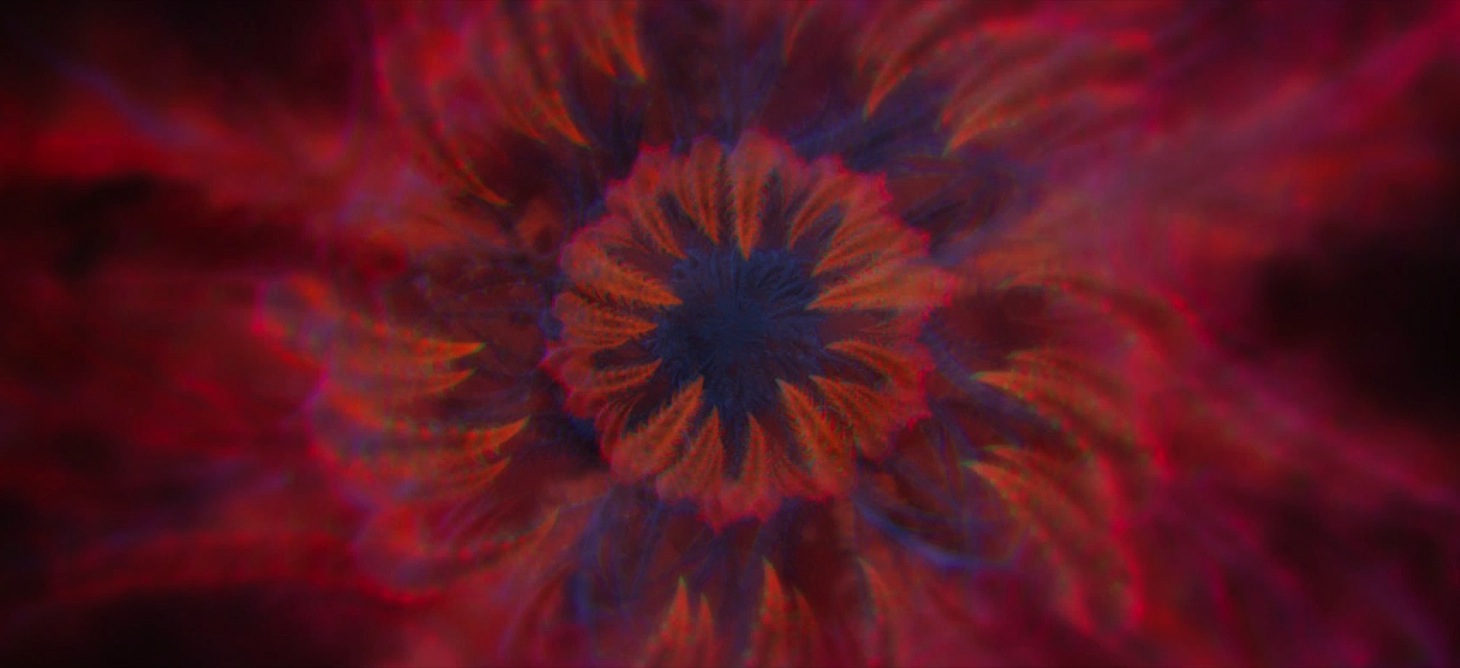
MAKING OF : jerome pesnel
MUSIC : Sigur Rós - Svefn-g-englar
NUMBER OF SHOTS : 349
Production notes
INTERVIEW GASPAR NOE
D’où vient l’inspiration de ce projet ?
J’ai eu une éducation athée mais, comme la plupart des athées, vers la fin de l’adolescence, quand on commence à fumer des joints, on commence aussi à se poser des questions sur la mort et sur l’existence d’un au-delà éventuel. Même si je n’ai jamais eu des tendances religieuses, j’ai commencé à m’intéresser aux livres traitant de la réincarnation, La Vie après la mort de Raymond Moody notamment, et je me faisais tout un film sur ce qui pourrait m’arriver si je venais à mourir. Cette peur de la mort s’estompe en grandissant, mais les premières idées de faire un film sur ce qui se passe après la mort du personnage principal viennent de cette époque-là. Plus tard, vers 23 ans, j’ai découvert sous champignons La Dame du Lac (Robert Montgomery, 1947), qui est un film entièrement en vision subjective et, tout d’un coup, j’ai été transporté dans la télé et dans la tête du personnage principal, bien que le film soit en noir et blanc et sous- titré. Je me suis dit que filmer à travers les yeux d’un personnage était le plus bel artifice cinématographique qui soit et que le jour où je ferais un film sur l’au-delà, ce serait en vision subjective. Des années plus tard, la scène d’ouverture de Strange Days de Kathryn Bigelow m’a confirmé l’efficacité de ce parti pris filmique. L’idée de ce film traînait donc depuis bien avant Carne ou Seul contre tous. Je l’ai écrit pendant près de quinze ans et je ne sais plus par combien de versions je suis passé. Les premières étaient beaucoup plus narratives et linéaires, les dernières plus abstraites et planantes. Irréversible était déjà une espèce de banc d’essai pour ce projet où j’ai testé des idées de caméras qui volent et des plans-séquences.
Quel est le lien entre les drogues et la mort ?
Des livres racontent comment les gens font des hallucinations au moment de leur mort, liées à la sécrétion de DMT dans leur cerveau. Cette molécule est la substance à l’origine des rêves et il paraît qu’une décharge massive peut se produire lors d’un accident ou de la mort. Cette molécule est la même qu’on peut absorber en grosse quantité dans certaines plantes d’Amazonie... Je n’ai jamais eu de mort clinique, ni été dans le coma, et je ne crois pas en une quelconque vie après la mort. Mais ça me plaisait de faire un film sur un personnage qui, pour se rassurer, a envie de croire en l’au-delà. Comme s’il faisait un dernier voyage en esprit et qu’il projetait ses obsessions, ses désirs et ses peurs selon le parcours post-mortem décrit dans Le Livre des Morts Tibétain.
A propos du Livre des Morts Tibétain : est-ce une source directe d’inspiration ?
Le film est-il une libre adaptation ou variation ?
Dans le descriptif de l’au-delà par Le Livre des Morts Tibétain, il y a surtout un voyage, une structure avec des étapes multiples dont la dernière est la réincarnation. Mais à l’intérieur, les visions ou les cauchemars ne sont pas décrits, cela relevant de la psyché ou de la vie passée du mourant. Le « Livre » est très abstrait, très coloré et très poétique. Et ce monde parallèle, où l’esprit désincarné peut flotter longuement, est décrit comme une réalité aussi illusoire que le monde des vivants lui-même. Beaucoup de gens se sont déjà inspirés de ce livre pour écrire des fictions (Philip K.Dick notamment) mais aussi pour guider des voyages collectifs sous LSD comme Timothy Leary dans les années 70. Bien que ce soit un texte religieux, ce livre est vite devenu un phare pour les hippies que j’admirais tant enfant.
Pourquoi avez-vous fait du personnage principal, auquel doit s’identifier le spectateur par le dispositif, un jeune dealer un peu loser ?
Il n’est pas que loser. C’est un petit winner jusqu’au moment où il ne contrôle plus sa bite et, en baisant la mère de son pote, se fait balancer aux flics. Pour la plupart des gens que je connais, le moteur principal dans la vie n’est pas du tout la drogue mais le sexe. La vente de drogue est plutôt une manière d’attirer l’affection. C’est un jeune chien fou qui fait de son mieux pour être heureux dans la vie. Et à ce titre, il est assez universel.
Est-ce ainsi depuis le scénario d’origine ? Etes-vous passé par d’autres types de personnages, avec des passés différents ?
Non. Dès le départ, je voulais en faire un personnage moyen, tout ce qu’il y a de plus normal. Ni peureux, ni vraiment courageux et un peu porté sur le cul, comme la plupart des gens qu’on dit « cool ». D’ailleurs, c’est peut-être pour ça que je l’ai appelé Oscar car ça me faisait penser à Gaspar, la personne à laquelle il m’est le plus facile de m’identifier.
Pourquoi en avoir fait un couple de frère et soeur ?
En tant que frère et soeur ils sont sortis tous les deux du même ventre. On a l’impression qu’ils sont comme les deux faces d’une même entité, et ce d’autant plus qu’ils ont presque le même âge... Sans être des jumeaux, il existe entre eux une dépendance existentielle. La mort de leurs parents les a déjà, en quelque sorte, privés de leurs jambes. La mort d’Oscar ou de Linda serait pour le survivant comme l’ablation de ses bras.
Est-ce que la relation presque incestueuse a toujours été présente ?
Je ne vois pas de relation incestueuse. Je vois par contre deux jeunes êtres perdus en manque d’affection. Ils veulent recréer la famille qu’ils ont perdue à tout jamais et luttent pour ne pas imiter le couple parental qui n’est plus. Il n’y a pas besoin d’être incestueux pour mal vivre le fait que sa sœur chauffe des blaireaux testostéronés alors qu’on cherche par tous les moyens à recréer le cocon de l’enfance.
Le thème de la méprise, ou de l’accident qui peut soudainement chambouler une vie et changer un destin est assez présent dans vos films. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce un simple ressort dramatique ?
Que ce soit dans Carne (un malentendu qui tourne au coup de poignard), dans Irréversible (le viol anonyme au détour d’une rue) ou l’accident de voiture de Enter the Void, il en ressort souvent qu‘on peut tout perdre en une seconde. La peur de perdre ses parents est la peur ultime de tout enfant et, en effet, c’est un ressort dramatique auquel n’importe qui devrait s’identifier. J’ai rencontré une fois une fille qui avait assisté avec sa petite soeur à la mort de sa mère dans des conditions très similaires. Quant à moi, j’avais eu très jeune un accident de taxi qui, bien qu’anodin en comparaison, est resté gravé dans ma mémoire. Mais le vrai ressort dramatique dans ce film est le pacte de sang des deux enfants, avec cette promesse impossible à tenir de se protéger mutuellement, même par-delà la mort.
L’action a toujours été située à Tokyo ?
La première version du scénario se déroulait dans la Cordillère des Andes, la deuxième en France et j’ai écrit une version en pensant tourner le film à New York... Mais pour moi, le Japon est le pays le plus fascinant qui soit et j’ai toujours eu envie d’y tourner un film. Pour ce projet précis, avec son aspect hallucinogène nécessitant des couleurs très vives, Tokyo (qui est l’une des villes les plus colorées et avec le plus de lumières clignotantes que je connaisse) était donc le décor idéal. Même si ça paraissait très compliqué au départ, tourner là-bas fût un plaisir énorme et je serais heureux de refaire un film au Japon. Malgré la complexité technique du tournage, l’équipe était tellement passionnée que même en travaillant quatorze heures par jour, six jours sur sept, j’avais l’impression de m’amuser. J’ai retrouvé l’énergie qu’on a, jeune, en faisant des courts métrages, mais avec des équipes surdouées et ultra professionnelles. Leur désir de perfection était aussi joyeux que contagieux. Par la suite, j’ai tourné au Québec avec une équipe tout aussi motivée et professionnelle même si les approches du travail sont très différentes. C’était assez drôle aussi de passer d’un tournage avec des acteurs post-adolescents bon vivants, à un tournage avec des enfants très touchants.
Le film comporte des mouvements de caméras très complexes...
Ma plus grande obsession quand j’ai commencé à préparer le film n’était pas de savoir qui allait jouer dedans, mais qui serait mon machiniste. Le plus compliqué c’était d’avoir quelqu’un de suffisamment doué pour trouver des systèmes de fixage de grue pour que la caméra vole en permanence en traversant les murs. Ça paraissait un pari technique impossible. On a essayé de faire fabriquer des prototypes. Finalement on pensait tourner dans des décors réels, mais on a dû beaucoup reconstruire en studio parce que c’était impossible autrement. Du coup on avait des énormes grues dans les studios et leurs mouvements étaient parfois limités. Je faisais des cauchemars dans lesquels la grue était bloquée et, tous les soirs, je rêvais de position de caméra et d’enchaînement de plans... Heureusement on m’a trouvé un machiniste japonais aussi génial qu’adorable. C’est même un miracle que le film soit techniquement aussi achevé, parce que chaque séquence soulevait un nouveau problème technique.
Le Love Hotel existe t-il réellement à Tokyo ?
Comme le « Void », ce Love Hotel a été créé de toutes pièces en studio. Il y en a beaucoup à Tokyo, mais les étrangers n’y sont pas vraiment les bienvenus et tout est écrit en japonais. Je me suis inspiré de livres de photos de love hotels, mais en poussant le côté psychédélique.
Combien de temps a duré le tournage ?
Le tournage à Tokyo a pris plus de trois mois. Celui à Montréal quatre semaines, pour les séquences d’enfance. Au départ je pensais à une ville comme New York où j’ai passé une partie de mon enfance. Ça me paraissait donc naturel que la petite enfance se passe là-bas. Mais pour des raisons de législation du travail on a finalement choisi le Canada car on pouvait tourner beaucoup plus d’heures par jour. Aux USA, ça nous aurait pris huit semaines au lieu de quatre.
Les dialogues étaient-ils écrits ou avez-vous improvisé dans l’esprit d’Irréversible?
Contrairement à Irréversible où il y avait un scénario de trois pages, on avait un scénario d’une centaine de pages mais avec très peu de dialogues... Comme le projet était très visuel, il fallait décrire le moindre détail et jusqu’à la couleur des nuages, pour aider les gens à visualiser un film qui paraissait extrêmement abstrait. Donc j’avais écrit tous les détails de mise en scène, les mouvements de caméra. Puis sur le tournage, pour certaines séquences, très souvent, je proposais aux comédiens de rajouter leurs propres dialogues et des actions une fois la prise « utile » tournée. Les dialogues ne sont jamais meilleurs que lorsqu’ils sont naturels aux comédiens. D’ailleurs si le film dépasse aujourd’hui les deux heures, c’est parce qu’il existe un temps naturel aux séquences. Si on essaye d’accélérer ce temps naturel, on arrive à des résultats trop informatifs et les situations ne vivent plus par elles-mêmes.
Comment avez-vous abordé le casting ?
Le parti pris était de ne pas avoir de comédiens qu’on puisse reconnaître, mais pas forcément des non professionnels car, pour le rôle de Linda, je voulais avoir une fille qui ait l’habitude de crier ou de pleurer sur commande, le film comportant de nombreuses séquences mélodramatiques. J’ai vu à la fois des jeunes actrices, des non professionnelles et des mannequins. Puis aux Etats-Unis, j’ai rencontré Paz de la Huerta que j’ai aimé plus que les autres. Il fallait ensuite que je trouve un frère qui lui ressemble physiquement, parce que je ne supporte pas les films où le frère et la sœur ne se ressemblent pas. Oscar (Nathaniel Brown) et Alex (Cyril Roy) eux, ne sont pas du tout des comédiens. La plupart des personnes à l’écran n’imaginaient pas qu’un jour ils joueraient dans un film. Ce sont des gens qui sont à l’aise dans la vie, ils s’amusent devant la caméra et je pense qu’à aucun moment, ni Nathaniel ni Cyril ne sentaient qu’ils travaillaient. Paz avait sans doute davantage conscience d’interpréter un rôle.
Comment Nathaniel Brown a-t-il pris le fait qu’on ne le voit jamais de face ?
Pour le rôle d’Oscar, qu’on ne voit jamais de face, j’aurais sûrement eu à gérer des crises de nerfs narcissiques à un moment ou à un autre si j’avais dû prendre un comédien. Du coup, j’ai choisi quelqu’un qui voulait être réalisateur et qui était enchanté de participer à un tournage en apportant des idées s’il le souhaitait. Il est très intelligent et il s’est avéré excellent sur le plateau. Lors d’une séquence en vision subjective où j’étais très fatigué, je lui ai même proposé de faire la caméra à ma place. J’ai rencontré Nathan environ dix jours avant le début du tournage. Il vendait des t-shirts à Brooklyn. Une semaine après, il était « star » de cinéma au Japon. Quant à Cyril, c’est un Français de Tokyo aussi barré que sympathique. Il accompagnait un de ses amis au casting qu’on faisait passer à des étrangers résidants à Tokyo. Il était venu parce qu’il était fan de Seul contre tous et d’Irréversible et qu’il voulait me parler. Et c’est une machine à parler... Je l’ai mis devant la caméra et soudain, j’ai vu le personnage que je cherchais depuis longtemps.
Comment définiriez-vous le genre du film ?
Mélodrame psychédélique.
Avez-vous toujours eu en tête ce coté psychédélique ?
Même si j’aime beaucoup Alan Clark, Peckinpah, Fassbinder ou certains réalisateurs qui représentent de manière plutôt réaliste la cruauté de l’existence, je voulais cette fois-ci faire un film hallucinatoire d’images et de couleurs, quelque chose d’onirique ou hypnotique où la beauté visuelle et le sensoriel prendraient le pas sur le factuel. Sans vouloir me comparer à de tels génies, cette fois-ci je pensais plus à certaines séquences de 2001 ou au travail de Kenneth Anger. Même s’il est souvent question de défonce, ce n’est pas un film sur la défonce, mais plutôt sur l’existence comme une dérive sans port d’arrivée. Le sujet principal serait plutôt la sentimentalité des mammifères et la chatoyante vacuité de l’expérience humaine.
Concernant l’intervention de Pierre Buffin en post-production, quelle est la part de plans tournés qui ont ensuite été truqués et celle, plus psychédélique, de création visuelle ?
Le film est en trois parties et comporte trois types de systèmes narratifs, chacun liés à des déformations de la perception. L’idée est de reproduire par des moyens cinématographiques des états altérés de la conscience et de se rapprocher autant que possible de la perception humaine, même pendant des phases de sommeil, d’agonie, etc. Au bout de la trentième minute, Oscar se trouve dans un état second et commence à avoir des hallucinations qui ne s’arrêteront qu’avec la fin du film. Quand on fait des effets spéciaux « mentaux », c’est comme improviser un concert sans avoir jamais été chef d’orchestre ni savoir jouer du moindre instrument : on dépend totalement de celui qui va choisir les musiciens et être capable d’harmoniser leur travail. A l’arrivée, un « goût » musical ressort, mais les instruments sont entre les mains des autres. Et là, avec Pierre Buffin et ses équipes, j’ai été on ne peut mieux entouré.
Comment communique-t-on des images mentales ?
Je me suis beaucoup documenté en regardant des films. J’ai archivé énormément de court- métrages, clips, bouquins ou tableaux, tout un dossier visuel et une collection très complète d’extraits (de Tron à 2001 ou les courts métrages de Peter Tscherkassky, par exemple), qui pouvaient donner une idée du type de film que je voulais faire. Une fois les plans tournés, on les met entre les mains des graphistes et animateurs et on essaye de passer d’une image réelle à une autre qui s’approche davantage de la référence donnée.
Le projet a-t-il été compliqué à monter financièrement ?
C’était assez facile de penser le film en image et à l’inverse, plus compliqué de le coucher sur papier pour le financer. Il y a eu plein de faux démarrages avec différents producteurs à des moments où, techniquement, le film était infaisable. Et je suis finalement content que le film ait autant traîné à se faire parce qu’aujourd’hui, grâce à l’évolution des techniques et aux compétences de Pierre Buffin et de son équipe, le film est devenu faisable d’une manière qui ne soit pas ridicule. Alors qu’il y a huit ou dix ans il aurait fait un peu théâtre de marionnettes mal ficelé. Donc la partie la plus difficile du film, plus que le tournage, plus que le montage ou la post-production, était de trouver l’argent et de convaincre des gens de tourner à Tokyo un film psychédélique à gros budget avec des séquences érotiques sans comédiens connus et avec le risque qu’il soit interdit aux moins de 16 ans... Heureusement, Vincent Maraval, de Wild Bunch, a tout fait pour lancer la machine. C’est lui qui m’a présenté Marc Missonnier et Olivier Delbosc, les producteurs de Fidélité, auxquels plus tard s’est associé Pierre Buffin en tant que coproducteur.
Le film a été présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, alors qu’il était loin d’être terminé et dans une version plus longue. Pourquoi avoir fait le choix de le montrer ainsi ?
Si on vous invite à participer au mondial de foot et que tous vos amis y vont, que le maillot de votre équipe soit prêt ou pas, vous vous en foutez, c’est aussi rigolo ou peut- être même plus de jouer torse nu. Bien sûr, l’image que les gens se font de vous est un peu moins civilisée. Mais c’est tout à la gloire du festival de Cannes et de Thierry Frémaux, prendre des risques et aller jusqu’à programmer des films en cours de finition. Je ne pouvais que répondre favorablement à cette demande et je suis plus qu’heureux d’avoir participé au championnat avec mes producteurs et mes collaborateurs principaux, même si on s’est tous retrouvé sur la pelouse, surexcité et la poitrine à découvert. Cannes est le seul festival au monde où les gens se déchaînent vraiment pour ou contre les films et, il faut l’avouer, j’aime bien ce genre de tourmente. Et, contrairement à l'année de Irréversible, j’ai été très fier de pouvoir partager cette fois le prix de la controverse avec Lars von Trier dont j’ai beaucoup aimé le film.
Dans la version finale, le traitement sensoriel, visuel et auditif du film a beaucoup évolué. Pouvez-vous nous en parler ?
Entre le moment où on a appris que le film pouvait être sélectionné pour Cannes et la date de présentation, il n’y avait qu’un mois pour faire d’une copie de travail très inachevée un film présentable devant une salle de cinq mille personnes remplie d’amis, mais aussi de mes pires ennemis culturels armés de leur kalachnikov. Ayant vu, quelques jours avant le documentaire sur le funambule qui avait traversé le grand vide entre les Twin Towers, on s’est dit avec mes producteurs que dans notre cas, il n’y aurait de toute façon pas mort d’homme et qu’on pouvait mettre les bouchées doubles pour ne pas rater la joie de relever le défi. Pierre Buffin a alors triplé l’équipe d’effets visuels de BUF pour parvenir à un résultat présentable. La copie présentée à Cannes a été montrée en vidéo haute définition et sans le moindre générique. Il s’agissait d’une sortie directe de mon ordinateur que j’avais moi-même étalonnée et qui avait été mixée en un temps record de trois jours. Je n’aurais jamais cru à l’avance que le résultat aurait été si probant. Mais après un mois de travail sans dormir, la vérité c’est qu’une fois la projection officielle passée, je n’avais plus aucune énergie pour faire les interviews ni même la fête. Mon seul rêve, c’était dormir. Depuis le festival de Cannes le film a été véritablement mixé et on a changé l’ensemble des musiques. Tous les trucages ont été améliorés et des effets de dédoublement ou de tremblotements d’image ont été ajoutés afin de rendre toute la seconde partie du film beaucoup plus mentale. Quelques passages ont été accélérés, d’autres raccourcis. Et surtout, j’ai enfin pu faire le générique de début qui n’existait pas à Cannes et qui aujourd’hui fait applaudir toutes les salles. J’ai enfin pu étalonner le film correctement et le transférer sur 35mm. La version finale du film a été présentée pour la première fois cette année à Sundance et, à ma grande surprise, le film a été comparé à Avatar, à cause de sa complexité technique ou son côté psychédélique, mais bien sûr pas à cause de l’univers décrit.
Voilà plusieurs années que vous travaillez sur Enter the Void. Ce film n’est pas sans rapport avec 2001, le film qui, dites-vous, a marqué votre existence. Comment s’inscrit-il dans votre filmographie ?
Comme beaucoup de réalisateurs, toute ma vie, j’ai rêvé de faire mon 2001 à moi... en y greffant d’autres émotions ressenties avec Eraserhead ou Inauguration of the Pleasure Dome. Le premier, j’ai du le voir au moins 50 fois, les autres presque une trentaine et je ne m’en lasse toujours pas. Mais, sans vouloir me comparer à ces immenses cinéastes, l’objet fini est à mille lieues de ces repères, certainement parce que les obsessions qui sont à l’origine de ce projet proviennent de mes 20 ans et qu’elles sont beaucoup moins adultes que celles de Kubrick, Lynch ou Anger. Du coup, je crois que c’est vraiment un film pour les adolescents en quête de perceptions altérées. Un film « trip », tel qu’on vendait 2001 à l’époque de sa sortie. Le résultat est quand même un ovni assez cher dans le système de production international et c’est justement ça qui fera peut-être son succès. Sans le soutien passionné de Wild Bunch, de Fidélité et de BUF ce film ne se serait jamais fait. A moins de s’attaquer aux religions, pour un réalisateur ou un comédien, un film n’est jamais risqué. Pour le producteur, ça l’est. Longue vie à eux !
INTERVIEW PIERRE BUFFIN
Directeur artistique des effets visuels & coproducteur
Quelle a été votre première réaction à la lecture du scénario ?
J’ai lu le scénario il y a environ huit ans et j'en suis tombé irrémédiablement amoureux... A l'époque, je ne connaissais ni Gaspar Noé, ni son travail. J'étais prêt à tout pour participer à la fabrication de cet ovni, surtout qu'entre temps je suis tombé amoureux de Gaspar et de son travail...
Avez-vous participé en amont du tournage à une phase préparatoire de conseil ?
Il y a eu beaucoup de discussions avec Gaspar, sur sa vision du film et sur ses attentes. Nous avons testé différents effets de prises de vues, définit les méthodes et techniques qui, sans alourdir le tournage, nous permettraient plus facilement d'intervenir sur les plans une fois tournés. Notre rôle avant le tournage était surtout de le rassurer sur la faisabilité de tel ou tel effet, de rédiger des notes techniques et d'expliquer nos méthodes de trucage à l'équipe de tournage.
Combien de personnes ont travaillé sur le projet ?
De 5 à 55 personnes sur une période de 2 ans.
BUF est coproducteur du film, est-ce la première fois que vous vous impliquez de la sorte dans un projet ?
Non, il nous arrive de coproduire à différents niveaux certains films. Généralement, quand on nous fait ce genre de proposition, ce n'est pas bon signe en termes financiers... Gaspar m'a successivement présenté de nombreux producteurs qui ont cherché à monter le film. Tous se sont heurtés à la difficulté de financer un projet aussi atypique dont presque tous les plans seraient à truquer, et où il était difficile de définir et chiffrer précisément ces trucages. Pour que le film puisse se faire, nous avons fini par comprendre qu'il fallait nous engager à prendre la responsabilité des effets.
Quelle a été la part de liberté de création d'effets visuels pour BUF ?
Notre rôle est de traduire par des effets visuels les idées et désirs du réalisateur. Gaspar nous a inondés de références. Nous avons fait de nombreuses recherches dont certaines très librement. Mais le but de ces recherches est, par élimination, de s'approcher visuellement de ce que souhaite le réalisateur. C'est un processus relativement long, et il faut généralement du temps pour faire un effet visuel qui sonne juste. L'équipe est ensuite intervenue sur l'ensemble du film en étroite collaboration avec le réalisateur. Les séquences filmées (en particulier les visions astrales et autres caméras subjectives) ont été raccordées afin d'assurer une continuité visuelle, stabilisées et restaurées au besoin. Toutes les images ont fait l'objet d'un traitement visuel progressif. Certaines parties ont entièrement été réalisées sur ordinateur, comme les séquences d'hallucinations lorsque Oscar fume du DMT, préfigurant la fuite de son esprit dans un univers aux formes organiques et inquiétantes. De même, la ville de Tokyo a été entièrement recréée pour permettre son survol onirique et mental.























